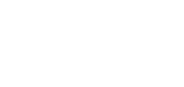DOMINIC RUEL
En 1664 – ce n’est pas d’hier –, Molière a écrit Le Tartuffe, une comédie en cinq actes, qui reste une œuvre intemporelle qui résonne encore très certainement aujourd’hui. Dans la pièce, Tartuffe se fait passer pour un homme pieux, un dévot, auprès d’Orgon, un riche bourgeois. Orgon se laisse manipuler et croit aux paroles de Tartuffe. Molière abordait les thèmes de l’hypocrisie, notamment religieuse, de la manipulation, du pouvoir et de la richesse.
En 2019, le doctorant en psychologue Rob Henderson développe le concept de « croyances de luxe », c’est-à-dire les idées, les positions, les opinions qui sont véhiculées en public par les classes sociales les plus favorisées. Il s’agit des discours tenus dans le but d’afficher une distinction sociale, un statut de personnalité de marque (VIP) et de bonnes habitudes, saines, responsables et éthiques. C’est un grand fossé entre l’image que l’on projette et nos motivations réelles. C’est le pouvoir des apparences. C’est aussi une façon de donner des leçons : « Regardez-moi, je suis une personne bonne, juste, sensible et responsable. » Cette même personne n’ajoute jamais : « mais je suis capable de me le permettre. » Concrètement, c’est l’alimentation locale ou bio que peuvent se payer les plus nantis. Ce sont les programmes scolaires et les écoles alternatives qui demandent des sous et du temps pour les parents qui doivent s’impliquer. Ce sont les dispendieux voyages écologiques et la mode vestimentaire éthique, plus chère qu’au magasin à rayons, mais qui sent bon la compassion. Ce sont les quartiers plus sûrs, sans trop de mixité, chers certainement, et peut-être sécurisés par des barrières. C’est le transport en commun au coin de la rue qui permet de regarder les automobilistes de haut. C’est une déconnexion totale des réalités quotidiennes : la majorité de la population n’est pas sans cœur, mais cette façon de vivre n’est pas réalisable, surtout financièrement.

Les croyances de luxe, c’est d’une certaine manière du signalement de vertu, une façon de discréditer les autres en adoptant des positions faciles, à la mode, souvent de façon hypocrite et, surtout, très visibles, en ville ou sur les réseaux sociaux. Ça attire l’attention et les mentions « J’aime », on dort ensuite mieux le soir, j’imagine. On peut parler aussi de « croyances ostentatoires », qui sont des idées ou des valeurs qui permettent de mettre de l’avant le statut social des gens riches, influents, puissants, de ceux qui comptent, mais sans nécessairement que cesdites valeurs soient mises en pratique par ces mêmes personnes. Une forme d’hypocrisie, comme chez Tartuffe.
Pour un article sur le sujet, il y a quelques années, le magazine Le Point titrait d’ailleurs « Ce n’est plus la dépense qui fait le riche, ce sont ses valeurs ». Cette théorie des croyances de luxe pousse plus loin l’idée de Thornsten Veblen qui parlait de « consommation et loisirs ostentatoires » : l’idée de montrer qu’on a suffisamment de temps et d’argent pour s’adonner à des activités, parfois improductives, et consommer pour afficher son statut social. Veblen a écrit cela en 1899, cela correspond, en quelque sorte, au « voisin gonflable » à plus d’un siècle de distance.