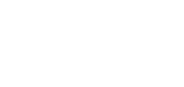DOMINIC RUEL
En cette rentrée 2025, je ne m’étendrai pas longtemps sur l’interdiction du cellulaire à l’école. Les enjeux sont connus et, finalement, je crois qu’il y a un consensus dans la population. Au-delà de la question du téléphone, c’est aussi, plus largement, une réflexion à faire sur le type d’école, d’enseignement et d’environnement scolaire que l’on veut et peut offrir aux élèves.
Je pars du principe que l’école doit offrir une expérience exigeante et différente aux jeunes : lire ce qu’ils ne liraient pas, écouter ce qu’ils n’écouteraient pas, réfléchir comme ils ne le feraient pas, évoluer dans un cadre stimulant, loin des réalités de la maison, de l’équipe sportive ou de la bande, vivre d’autres expériences intellectuelles (oui, c’est l’école!) que celles des réseaux sociaux et de leur entourage. Interdire le cellulaire est donc une première pierre à l’édifice.
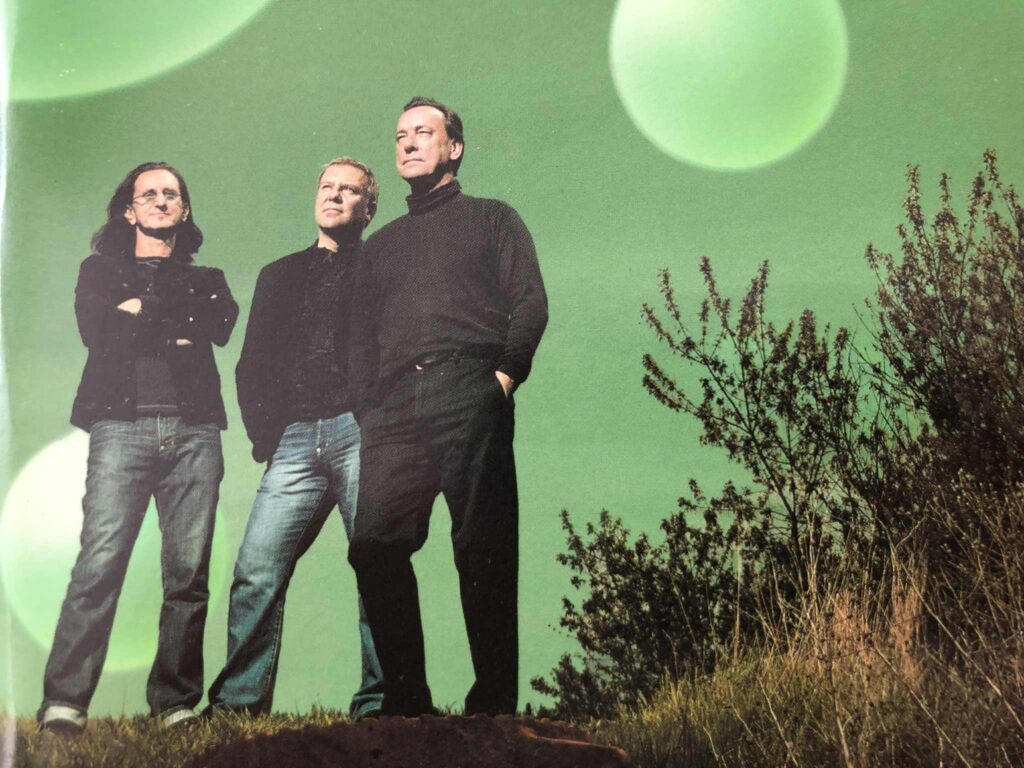
L’école doit aussi s’éloigner de l’utilitarisme. J’écrivais ici, il y a plus près de quinze ans, que l’école n’était pas un fourre-tout devant répondre aux mille demandes des familles et de la communauté qui l’entourent. Le temps en classe reste limité et il faudra faire un tri afin de revenir à l’essentiel. Il faut du temps pour apprendre à lire, écrire, compter et penser. Il faut des connaissances et des compétences pour devenir un citoyen sensé, réfléchi et ouvert d’esprit, des compétences que l’on a appelées « transversales », comme la pensée critique, la résolution de problèmes et la créativité, qu’on peut développer par l’apprentissage par projet, avec des ressources variées et des retours réguliers sur les bons coups et les erreurs de parcours. Puis, le cerveau étant comme un muscle, il doit travailler pour être plus fort. Lever des poids dans une salle de gym n’est utile que pour gonfler les biceps. Le théorème de Pythagore, le tableau périodique et les constitutions de l’histoire du Québec renforcent les méninges, les entraînent.
L’école doit aussi rester l’école, un lieu sain et sécuritaire, certes, qui offre ses symboles, uniques, qui créent un environnement différent, avec ses codes, ses limites, ses décors. Les règlements, particuliers à l’établissement, dont l’interdiction du téléphone cellulaire, sont un exemple. Les cloches qui marquent le début et la fin des cours aussi. Des portraits de finissants, des travaux d’élèves affichés sur les murs, la manière de s’adresser aux autres en sont également (le vouvoiement comme norme, autre nouveauté!). Puis, allons-y, l’uniforme, qui élimine les modes, les tendances, les messages et les classes sociales, le plus possible. Tout ça, mis ensemble, renforce très certainement le sentiment d’appartenance, crée une culture commune, offre un cadre qui favorise l’apprentissage en plus de structurer et d’encadrer les comportements.
Une école « sanctuaire », donc? Le terme est mal choisi. L’école ne sera jamais coupée totalement du monde, qu’on le veuille ou non. Une école « presqu’île », alors? Ni totalement isolée, rigide et seule à apprendre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, ni complètement connectée et ouverte aux modes et aux tendances du moment présent.