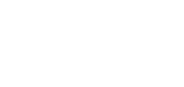PHILIPPE MARQUIS
Il y a de ces pensées qui frappent parce qu’elles sont impossibles à contredire. « Mieux vaut prévenir que guérir! » en est un bel exemple. Si on évite de fumer des « topes », on a moins de chances de mourir d’un cancer du poumon. On pourrait dire aussi qu’avec des appartements assez nombreux pour loger dignement tout le monde, il aurait bien moins de personnes itinérantes. Peut-être même aucune!
« Mieux vaut prévenir que guérir! » Une amie asthmatique m’a lancé cela, un jour de juillet, avant d’annuler sa présence à une cueillette de bleuets. La Santé publique avait publié une mise en garde sur les dangers de l’air chargé de monoxyde de carbone en raison des feux de forêt qui nous emboucanaient encore les vacances. Malheureusement, le magnifique spectacle d’un soleil rougeâtre tôt le matin et en fin de journée n’a rien de naturel. En réponse aux dangers d’exposition, la Santé publique y est allée d’avertissements. Dans un but de prévention, on a installé, par exemple, des affiches dans les résidences de personnes âgées.
La Santé publique réunit, en bref, des personnes qui travaillent à protéger le bien-être de la population. Ces gens, médecins et spécialistes, cherchent à améliorer et à soutenir notre santé grâce à des efforts collectifs. Leurs actions se concentrent principalement sur la prévention. Alors, mon amie n’est pas allée aux bleuets cette fois, ni son père âgé de 72 ans.

Certains me diront qu’elle pourrait prévenir encore davantage en dénonçant ce système qui surchauffe notre planète au point où les canicules deviennent aussi normales que les mensonges du président américain. Celles qu’on nomme les autorités sanitaires pourraient donc exiger une réduction radicale de l’utilisation des carburants fossiles. Ici, cependant, il faudrait que le politique s’en mêle.
Je ne sais trop d’où vient mon envie de parler de fumée en ce début d’automne. Peut-être que c’est dans l’air du temps. Vous souvenez-vous de l’époque où on fumait partout : dans les écoles, les restaurants, les hôpitaux? Lorsque le ministre de la Santé Jean Rochon dépose le projet de loi 444, Loi sur le tabac, en 1998, la révolte gronde. C’est ce que nous apprend un article intitulé Petite histoire de la lutte contre le tabac au Québec. Ce projet de loi rencontre une opposition monstre. Les compagnies de cigarettes menacent de quitter Québec, les syndicats du tabac veulent protéger de bons emplois et les pharmacies vont devant les tribunaux pour conserver leur droit de vendre du tabac. La Chambre de commerce du Québec prévoit même une perte de productivité parce que les employés quitteront leur poste pour aller fumer. La loi a été adoptée en juin 1998, puis revue plus sévèrement en 2005.
Depuis, nous sommes passés de 2 personnes sur 5 (40 % des gens) à 1 personne sur 5 (20 % de la population) qui fume. Les catastrophes annoncées ne sont pas advenues et tout le monde s’en porte mieux.
Personnellement, je ne ramasse ni surtout ne mange les bleuets sur le cap rocheux devant chez moi. Les vents dominants portent régulièrement la boucane d’une fonderie bien connue sur mon quartier. Lorsqu’elle n’est pas discréditée, la Santé publique, consciente des dangers relatifs à ces dépôts de poison, tente de prévenir la population. Il ne manque plus que des gouvernants prennent leurs responsabilités afin qu’on puisse juste respirer en toute confiance…