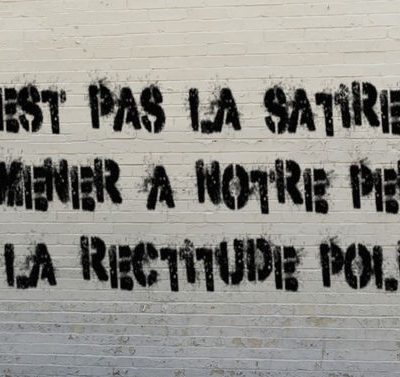À une époque de ma vie, j’ai été planteuse d’arbres. Pas dans l’aménagement paysager. J’ai planté pour des compagnies forestières à une échelle industrielle qui se compte en milliers d’arbres par jour. J’ai un souvenir très précis du premier voyage entre Lebel-sur-Quévillon et le camp, sur la route 105. Un vieil autobus jaune déclassé pour le transport scolaire nous servait de moyen de transport collectif vers le village de roulotes de chantier qui serait notre foyer pour l’été à venir. Sur le pare-chocs avant, une pancarte attachée avec de la broche : Le-Hell-sur-Quévillon.
Ça fait des mois qu’on rêve de ce jour mythique, comme un voyage initiatique vers des contrées lointaines où nos limites seront repoussées au-delà de notre compréhension. On monte chacun notre tour dans ce rafiot branlant pour s’élancer à 100 km/h sur une route de gravier où se croisent travailleurs forestiers et poids lourds hors norme vidant la forêt de ses entrailles. Le foreman au volant prend bien soin de mettre dans le lecteur cassette ce qui se fait de plus trash, question de ne laisser aucun doute sur l’expérience qui s’en vient. Dehors, à 360 degrés, une forêt calcinée s’étend à perte de vue. Pas un brin de vert dans tout ce charbon. Dix kilomètres où le feu de l’année d’avant a avalé la moindre souche, le moindre nid d’oiseau. Moi qui me croyais abitibienne, je n’avais jamais vu une coupe à blanc, qui n’avait de blanc que l’espace vide entre les traces d’une vie disparue.
Je suis restée sans mots devant le spectacle. J’ai pleuré pendant plusieurs minutes, comme en choc. Aussi spectaculaire que soient les images, voir un feu de forêt aux nouvelles n’a rien à voir avec l’expérience de marcher sur un sol calciné où le décor a disparu. J’essayais de visualiser la forêt, les orignaux, les perdrix. Partis en fumée. C’est là-dedans que nous allions travailler puisque c’est pour ça que j’y étais montée.
Le plus étrange, c’est qu’une fois accoutumé au désastre, le fait de planter des arbres dans un endroit comme ça relève du fantasme pour un planteur d’expérience. Pas de verdure pour nous faire perdre nos repères, pas de framboisiers pour nous grafigner la peau, pas de branches pour nous enfarger. Comme quoi tout est relatif. On s’habitue à tout, d’autant plus qu’on est dans cette galère pour essayer de faire de l’argent.
Au fil des jours, un changement se produit, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. La vie s’appelle à elle-même. Dans le charbon de la terre se cachent des merveilles en devenir. C’est le grand cycle de la vie et de la mort. Je suis à la fois dans l’immensité du territoire et dans un monde infiniment petit rempli de surprises. Et dans la routine d’un matin de juin, je vois éclore le premier iris versicolore de l’été, splendide et farouche, qui s’offre à moi toute seule au fond d’un terrain vaseux. Le cri d’un huard dans le silence de l’aube. Le premier bleuet de l’été, je le vois mûrir, puis je le cueille et je le mets encore tiède dans ma bouche. Ces toutes petites choses en apparence banale prennent soudain une forme très nette dans ma conscience. Elles me procurent une joie pure, un sentiment de gratitude. La laideur du début s’est transformée. Je comprends que pour que la vie renaisse, il faut souvent de grands bouleversements. Du chaos surgit nécessairement une forme d’harmonie, pour qui sait y voir. Les saisons rudes de chez nous participent à la même danse éprouvante.
Quand je passe trop de temps devant mon écran à m’abreuver de tout ce qui va mal, et Dieu sait qu’il y a de quoi se mettre sous la dent en matière de misère, je retrouve le même sentiment de désolation et d’impuissance que m’avait fait ressentir la vue de la forêt calcinée. La tristesse m’englue.
Il faut savoir où poser son regard pour apprendre à voir ce qui vaut la peine d’être vu. Il faut regarder pousser les fleurs de notre jardin et, comme le dit le poète Nicolas Lauzon, il faut prendre le temps de regarder le jour mûrir avec les bleuets. On oublie souvent la chance qu’on a de vivre dans une région comme la nôtre, car bien que son climat nous en fasse vraiment voir de toutes les couleurs, on oublie parfois de s’apercevoir que ces couleurs font justement partie de la beauté de l’œuvre. Pour voir dans toute leur splendeur les verts tendres des bourgeons, rien de mieux qu’un printemps trop longtemps gris. Revoir les tiges motivées de mes pivoines se pointer à travers le feuillage jauni de la saison passée, prêtes à livrer une floraison spectaculaire comme si leur vie en dépendait. Je trouve ça vraiment beau.
Je partage cette petite tranche de vie parce que je pense que l’été est un moment de répit où il faut faire le plein de beauté, se saturer les yeux et le nez avec les parfums de la forêt, des lacs, des petits fruits. Quoi de plus parfait qu’une framboise sauvage? Il faut le faire de façon consciente parce que tout n’est pas toujours beau, tout n’est pas toujours parfait. Mais quand le moment est venu pour que le miracle se produise, il faut être au rendez-vous. Et si les framboises ne sont pas votre truc, c’est peut-être sur une terrasse en ville que vous trouverez votre bonheur dans un verre partagé avec un ami. L’été, on a le droit d’être moins vigilant et d’accueillir le bonheur des petites choses en toute simplicité.
Comme une grande roue qui tourne, les numéros de L’Indice bohémien s’enchaînent. Ainsi, vous avez entre les mains son centième numéro. Ce journal, fruit du travail coopératif de toute l’Abitibi-Témiscamingue, est un miracle qui se produit encore et encore. C’est un outil de communication et de développement qui vit grâce à vous tous, lectrices et lecteurs. On vous dit un immense merci d’être au rendez-vous!