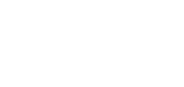LEHANN BOUCHARD, STAGIAIRE AU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
L’été 2025 a été marqué par une forte présence d’insectes mal-aimés. Que ce soient les essaims de mouches sarcophages, de moustiques volant autour de vous ou de longicornes noirs s’accrochant à vos cheveux, c’était un vrai cauchemar pour toutes les personnes de la région qui sont atteintes d’entomophobie! Cependant, la palme de l’insecte le plus redouté en cette période estivale revient à la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE), une chenille indigène très abondante dans la région depuis quelques années.
Ce printemps, la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies (SOPFIM) a aspergé d’insecticide biologique Btk environ 90 000 hectares de forêts boréales en Abitibi-Témiscamingue dans le but de prévenir les dommages causés par la TBE. Pourquoi tant de mobilisation contre cet insecte?

UN APPÉTIT VORACE
Dans un premier temps, la TBE parasite le sapin baumier et toutes sortes d’épinettes – blanche, rouge, noire, de Norvège – en plus d’autres espèces de conifères comme le mélèze laricin. Ce ravageur est donc très nuisible dans les forêts boréales où ces essences sont fortement présentes. Néanmoins, la TBE ne tient pas seulement son nom des hôtes qu’elle infeste, mais aussi de son comportement alimentaire. En effet, au début de mai, les chenilles sortent de leur état d’hibernation et se dirigent vers le bout des branches pour attendre l’ouverture des bourgeons. Dès l’apparition des nouvelles pousses, les chenilles tissent un abri, composé de déjections, d’aiguilles et de soies, dont elles vont se nourrir jusqu’à leur transformation en chrysalide au début juillet. Pendant ces deux mois d’activité, la TBE peut ravager entièrement le feuillage de l’année et s’attaquer aux feuillages des années antérieures.
CYCLES LONGS ET PERSISTANTS
Dans un second temps, il est important de mentionner que la défoliation des conifères infectés par la TBE ne serait pas problématique si elle ne se répétait pas d’année en année. Autrement dit, la défoliation ne cause pas de mortalité dans un peuplement dès la première année, mais peut commencer à partir de la quatrième année et se poursuivre graduellement. Cela est bien dommage sachant que les épidémies de tordeuses dans un secteur durent au moins de 10 à 15 ans et qu’elles sont cycliques – c’est-à-dire qu’elles reviennent après une trentaine d’années. Au Québec, depuis le début des années 1900, cinq épidémies de TBE ont été notées, soit en 1909, en 1938, en 1967, en 1992 et plus récemment, en Abitibi-Témiscamingue, en 2007.
UN MAL… UTILE?
Bien que ces épidémies soient dommageables d’un point de vue économique, notamment pour le domaine forestier, elles jouent toutefois un rôle essentiel dans la dynamique naturelle des forêts. En réalité, la mort des arbres plus âgés et vulnérables crée des conditions favorables à la germination et à la survie des semis présents dans le sol. Ce processus de rajeunissement de la forêt engendre simultanément la création d’habitats de choix pour de nombreuses espèces fauniques. Cela signifie que les épidémies de TBE sont bénéfiques pour la biodiversité!
ET SI?
Même si les personnes souffrant d’entomophobie préféreraient que tous ces insectes disparaissent, sachez que chacun d’entre eux, nuisible ou pas, a un rôle important à jouer. La présence des mouches sarcophages, parasite de la livrée des forêts, a permis de tuer dans l’œuf l’épidémie qui se préparait à l’été 2024.
Quant aux longicornes noirs, dont l’explosion de la population a été causée par les feux de forêt de 2023, ils accélèrent la décomposition des arbres morts et fertilisent ainsi les sols forestiers. Oui, même les moustiques jouent un rôle essentiel de pollinisateur! Bref, avant de maudire ces petits êtres, souvenons-nous : dans la nature, chacun a son rôle à jouer.