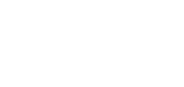PHILIPPE MARQUIS
Cela s’est passé à Québec en 2022, avant les dernières élections provinciales. Me promenant dans le quartier St-Roch, je tombe sur un très grand graffiti. Des lettres blanches, larges et bien tracées ressortent avec force sur le mur de briques : « Si voter pouvait changer quelque chose, ça serait déclaré illégal! »
La phrase frappe par sa simplicité et la sincérité qui en émane. En y réfléchissant bien, il est vrai que voter, comme on pourra le faire aux élections municipales du 2 novembre prochain, ne règlera rien de manière automatique. Si tout pouvait s’arranger par le vote, nous vivrions dans un monde sans inégalités ni destruction de la faune et de la flore. Pour ne citer que ces sujets…
Bien entendu, si on se rend à l’isoloir (il y a souvent moins d’une personne sur deux qui le fait au palier municipal), on ne fait finalement que voter. La mise en place du compostage, comme cela se fait maintenant presque partout, a demandé bien des pétitions et des arguments convaincants, parfois aussi des gestes plus radicaux afin d’y arriver. Oui, des citoyennes et citoyens se présentant à leur conseil municipal ont porté ce dossier lors d’élections, mais il a d’abord fallu que des gens engagés sensibilisent la population. Ce nécessaire et patient ouvrage qu’exige une citoyenneté assumée, c’est cela qui mène au véritable changement. La présence des pistes cyclables est un autre exemple de résultat de l’engagement citoyen. Je vais au plus simple, cela est pourtant aussi vrai pour des enjeux bien plus cruciaux.
Le palier municipal est le plus près des gens et le plus accessible. On parle de lui comme étant un gouvernement de proximité. Dans les grandes villes de notre région, les séances des conseils municipaux se tiennent deux fois par mois. La fréquence est d’une par mois dans les petites municipalités. C’est l’occasion, pour les citoyennes et citoyens, de poser des questions directement aux membres de leur conseil. Il y est toujours possible d’amener des propositions pour améliorer le bien-être collectif. Une telle chose n’a rien de possible aux parlements de Québec ou d’Ottawa.
Les villes et villages ne s’occupent pas juste des routes et des rangs. La gestion des déchets, des bibliothèques, des arénas et des autres infrastructures est sous la responsabilité des conseils municipaux soutenus par leur personnel. La sécurité incendie, la qualité de l’eau, le logement, la lutte aux changements climatiques et l’aménagement du territoire représentent d’autres domaines où les conseils municipaux doivent intervenir.
C’est dans ces territoires que nous vivons, c’est ici que nous devrons affronter ensemble les défis et c’est ainsi que nous nous donnons des vies qui ont de l’allure. Dans les cinq dernières années, les instances locales de notre région ont fait face à deux crises majeures : l’épidémie de COVID-19 et les feux de forêt de 2023. Ce n’est pas François Legault qui était directement au bâton, mais bien les populations.
Oui, ça peut commencer par un X sur un bulletin de vote, ce qui reste un choix bien individuel, mais on a besoin de bien plus. On a besoin de tout le monde pour la suite du monde.