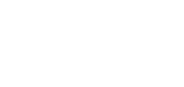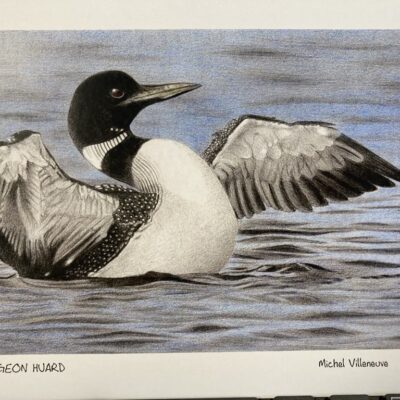LOUIS-ERIC GAGNON, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
En juillet, le ministère de la Culture et des Communications a mis à pied une trentaine d’employés. Parmi eux se trouve un poste clé en Abitibi-Témiscamingue. Ce n’est pas un simple ajustement administratif, c’est un coup porté directement au cœur culturel de notre région.
UNE RESSOURCE IRREMPLAÇABLE
Le milieu artistique en région travaille d’arrache-pied. Il fait rouler une économie locale, il crée du sens, il tisse des liens. Il est toutefois constamment fragilisé et maintenu en équilibre précaire. Chaque ressource que l’on perd ajoute une pression immesurable sur nos activités. Ce jeu de yo-yo budgétaire doit cesser. Il est temps d’assurer un financement stable et prévisible, et de réinvestir à la hauteur de l’impact réel de la culture dans nos communautés.
Le poste supprimé était occupé par une personne qui comprenait le territoire, ses dynamiques, ses contraintes et, surtout, ses possibilités. Cette personne avait une vision globale du milieu culturel, agissait comme facilitatrice, et possédait une mémoire vivante du secteur. Elle accompagnait les musées, les organismes, les médias, les artistes, etc. Une seule rencontre avec elle suffisait parfois à faire débloquer des mois de travail. Retirer ce poste, c’est couper une veine culturelle vitale. Ce n’est pas juste un emploi de moins. C’est une voix qui s’éteint.
GÉRER À DISTANCE, C’EST PERDRE LE LIEN
L’Abitibi-Témiscamingue est un territoire immense, reconnu comme isolé par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). On ne peut pas gérer à distance la culture d’ici. L’accompagnement doit se faire en personne, sur place. C’est une question de cohérence, mais aussi de respect. Notre région est vaste, autonome, multiple. Elle reflète un Québec que je chéris : accueillant, indépendant, pluriel. Elle mérite d’être soutenue pour ce qu’elle est, et non pas gérée comme une extension de l’Outaouais.
Historiquement, notre direction régionale comptait quatre postes professionnels. C’était justifié par l’étendue du territoire, par la couverture du Nord-du-Québec et par les dossiers autochtones complexes à gérer. Cette réalité n’a pas changé. Pourquoi, alors, nous amputer davantage? En 2014, nous avons perdu le poste de direction régionale. À l’époque, il nous avait été promis de conserver les autres postes. Force est de constater que ces promesses ne tiennent plus.
NOS VOIX RÉGIONALES MENACÉES
Au-delà de la structure ministérielle, c’est aussi tout un écosystème culturel qu’on affaiblit. Prenons l’exemple des médias communautaires. Je parle ici d’expérience : j’y ai fait mes débuts, j’y travaille encore aujourd’hui, et j’y ai formé la relève pendant les cinq dernières années. Ces médias ne sont pas interchangeables. Ils ne seront pas remplacés par les réseaux sociaux. Ce sont des voix uniques, proches des gens. Des outils rassembleurs. Des lieux d’expérimentation et d’émancipation. Et pourtant, leurs ressources fondent. Plusieurs sont à risque de disparaître dans les cinq prochaines années. Quelle vision avons-nous de la culture si nous laissons ces médias s’éteindre en silence?
DES CONSÉQUENCES EN CASCADE
Une coupe comme celle-ci ne reste jamais isolée. Elle a un effet domino. Moins de ressources au ministère, c’est moins d’accompagnement pour les organismes. Moins d’accompagnement, ce sont des projets qui ne voient pas le jour, des festivals qui rétrécissent, des demandes de subvention qui restent incomplètes ou sans réponse. Et, chaque fois qu’une activité disparaît, ce sont aussi des retombées économiques en moins : moins de contrats pour les artistes, moins de visites pour nos commerces, moins de visibilité pour notre région. À terme, cette fragilisation sert d’argument pour couper encore plus. C’est un cercle vicieux qu’il faut briser maintenant.
Enfin, supprimer ce poste envoie un message inquiétant : que l’accès à la culture dans les régions isolées est secondaire. Que notre réalité est invisible. C’est faux. Et c’est dangereux.
Et si on nous coupe encore, ce n’est pas juste la culture qu’on affaiblit : c’est notre capacité, comme communauté, à se tenir debout.