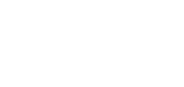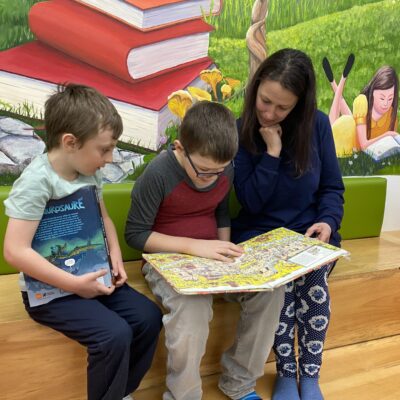DOMINIQUE ROY
Les membres du groupe Les Cowboys Fringants ne le savent probablement pas, mais Plus rien fait œuvre utile en Abitibi-Témiscamingue. Quand elle a écouté cette chanson pour la première fois alors qu’elle avait 14 ans, un premier déclic s’est produit chez la Témiscamienne Ariane Barrette. Les paroles qui résonnaient en elle ont fait naître de profondes réflexions sur l’état de la planète et cette urgence de la préserver. Déjà, elle le savait… l’avenue scientifique ferait partie intégrante de sa voie professionnelle.
Après un diplôme d’études collégiales en sciences de la nature au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, un certificat en études de l’environnement, un microprogramme de 1er cycle en écologie pratique et un baccalauréat en écologie à l’Université de Sherbrooke, voilà que la jeune femme est aujourd’hui étudiante à la maîtrise en écologie et aménagement des écosystèmes forestiers à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Le projet de recherche sur lequel elle planche vise à mesurer les impacts de l’introduction de poissons sur les communautés aquatiques des lacs sur esker en Abitibi-Témiscamingue.

ENSEMENCER… MAIS À QUEL PRIX?
Dans son projet de recherche, Ariane Barrette parle du déclin considérable des espèces d’eau douce depuis 1970 et de l’ensemencement qui apparaît comme une solution à la conservation des populations de poissons et à la mise en valeur de la pêche récréative. Cependant, cette action est synonyme de conséquences écologiques, entre autres pour les lacs naturellement sans poissons.
Son terrain de jeu : 36 lacs sur esker situés en Abitibi-Témiscamingue, précisément dans les MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest et de Rouyn-Noranda. Ce qu’il faut savoir, c’est que les lacs sur esker sont issus de la fonte des glaciers il y a des milliers d’années. « Pendant le retrait du glacier […], des blocs de glace se sont détachés de celui-ci et se sont enfouis dans les dépôts sablonneux de ces formations. Ces blocs ont créé des dépressions qui ont ensuite évolué en lacs de kettle sur esker », explique l’étudiante. Naturellement, ces lacs sont dépourvus de poissons. Au fil des ans, certains ont été ensemencés artificiellement alors que d’autres ont été colonisés naturellement par des poissons. Or, comme les impacts d’une telle introduction n’ont jamais été décrits, la chercheuse a donc entrepris d’en évaluer la portée. Ce qu’elle veut savoir, c’est à quel point les amphibiens et le zooplancton présents dans ces lacs sont affectés par l’arrivée inattendue des poissons.

Dans ce long processus, Ariane Barrette ne s’en cache pas, c’est la collecte de données sur le terrain qui lui plaît davantage : « Par exemple, en écologie aquatique, on échantillonne des lacs en installant des filets de pêche et on prend diverses données sur les poissons qu’on capture, les amphibiens, les macro-invertébrés ou encore le zooplancton. On prend des données physico-chimiques dans le lac, comme la concentration en nutriments ou le taux d’oxygène dans l’eau. C’est toujours une aventure avec plein de défis, d’imprévus, de petites mouches, mais qui me permet de passer du temps dans la nature et de faire de belles observations. »
Bien que la recherche ne soit pas terminée, « déjà, les résultats préliminaires montrent que la présence de poissons dans les lacs sur esker a un effet négatif sur l’abondance des têtards et sur la présence des masses d’œufs d’amphibiens », indique l’étudiante.

LA CONTRIBUTION DE CETTE ÉTUDE
Ainsi, la recherche d’Ariane Barrette, sous la direction du professeur Guillaume Grosbois (UQAT, Institut de recherche sur les forêts [IRF], campus d’Amos) et de la professeure Katrine Turgeon (Université du Québec en Outaouais [UQO], Chaire de recherche du Canada en socioécologie de la conservation et de la gestion des poissons et de la faune), permettra d’obtenir une information vitale qui guidera les actions à privilégier pour mieux conserver et gérer ces écosystèmes fragiles, vulnérables et de plus en plus rares.