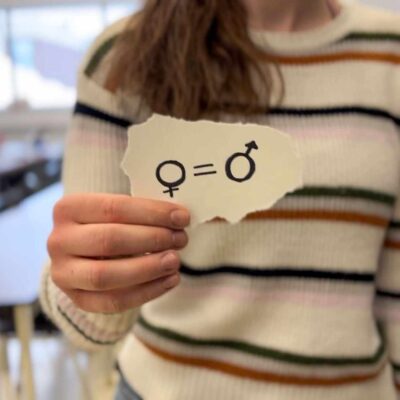Je me demande combien de gens font le choix de quitter leur pays par pur plaisir. Combien d’immigrants sont heureux de laisser derrière eux la majorité de leur famille, sachant qu’ils ne les reverront plus qu’une fois tous les deux ou trois ans, parfois moins, parfois jamais?
Je me demande qui serait prêt à échanger sa place avec une mère syrienne réfugiée qui a vu sa maison démolie sous les bombes. Qu’est-ce qui peut bien motiver un ouvrier roumain à se cacher dans un conteneur maritime pendant des semaines au péril de sa vie pour aboutir comme débroussailleur dans le Nord québécois? Quel choix de vie s’offrait aux prisonniers politiques relâchés par les Allemands après la Seconde Guerre mondiale pour qu’ils choisissent de finir sous terre dans les mines de l’Abitibi? Quelles sont les histoires troublantes provenant du Chili, d’Haïti, de Russie ou des Philippines qui sont à l’origine du choix ou de l’obligation de tout laisser derrière? Une famille nombreuse à nourrir? Un dictateur sanguinaire qui fait la chasse aux intellectuels et aux journalistes? Une homosexualité socialement inacceptable? Les histoires sont multiples, complexes et parfois tissées de drame. Parfois, heureusement, elles sont aussi de belles histoires d’amour.
Dans les années 1930, Rouyn-Noranda était la deuxième ville comptant le plus d’immigrants par tête de pipe après Montréal. Italiens, Ukrainiens, Roumains, Polonais. Ils ont bâti la ville, creusé les mines. Même scénario à Val-d’Or. L’ADN de l’Abitibi-Témiscamingue est le résultat de ces métissages avec les colons canadiens-français. Aujourd’hui, l’UQAT est un autre moteur favorisant l’accueil de professeurs hautement compétents issus de tous les coins du monde. Pour des régions comme l’Abitibi-Témiscamingue, l’immigration est une nécessité et une richesse.
Mais l’immigration comporte son lot de défis, tant pour la société d’accueil que pour ceux qui arrivent. La seule issue possible pour trouver l’équilibre entre rester soi-même et trouver sa place dans un nouveau pays, c’est le dialogue. Le « flux bidirectionnel », comme le dirait si bien Boucar Diouf. Bien entendu, occuper un emploi compte pour beaucoup dans la réussite de cette nouvelle vie, mais tout le reste compte au moins autant : avoir des amis, une vie sociale, des activités sportives. Parce que la vie ne se résume pas juste au 8 à 4 du boulot.
Je comprends dans une certaine mesure la vision comptable justifiant qu’un gouvernement souhaite arrimer les besoins de main-d’œuvre de son pays en sélectionnant certains profils de travailleurs qualifiés. Le monde des affaires le demande pour le bien de leurs entreprises. Mais l’humanité ne peut pas s’enfermer dans les petites cases du formulaire Arrima de la CAQ.
Un immigrant, ce n’est pas de la marchandise qu’on peut importer dans un conteneur. Ce n’est pas un robot formaté pour les besoins de l’économie. Ce n’est pas une solution simple à un problème de manque de main-d’œuvre criant, qu’on aurait dû voir venir depuis au moins vingt ans et pour lequel assez peu de mesures réelles ont été prises. L’immigration, ce n’est pas juste des soudeurs malgaches sélectionnés sur le volet ou des gérants de McDonald recrutés au Maroc. Ce sont des humains en quête d’une vie qui leur offre des occasions d’épanouissement, comme à vous et moi. Et qui, bien souvent, ont beaucoup de mal à faire valoir leurs compétences faute d’un réel désir structurel de voir réussir « l’intégration ». Intégrer un immigrant dans une équipe, ça demande du temps, de la volonté et beaucoup de respect. Des heures supplémentaires pour l’accompagnement social et humain. Une dose d’amour.
D’ailleurs, si la volonté politique était suffisante, elle aurait peut-être réussi à vaincre l’entêtement malsain des ordres professionnels à ne pas reconnaître les diplômes et l’expérience des immigrants qualifiés. C’est inadmissible qu’une médecin algérienne devienne préposée aux bénéficiaires dans notre système de santé qui est en pénurie. Les facultés d’enseignement auraient dû, depuis longtemps, offrir des formations transitoires pour arrimer les compétences des immigrants avec les réalités de la société d’accueil et permettre que le travailleur intègre son métier dans des délais raisonnables.
J’ai vu le même scénario navrant dans une école primaire de mon quartier. Une enseignante française avec 17 ans d’expérience au primaire n’a pas réussi à décrocher son permis d’enseignante, et elle est repartie pour la France avec sa famille deux ans plus tard. Est-ce que le programme éducatif français est à ce point incompatible avec le nôtre? Ou est-ce que le problème ne vient pas d’une incapacité politique à trouver des solutions aux blocages administratifs? Je trouve parfois mon Québec bien hypocrite.
De la place au Canada, il y en a pour tout le monde. Les régions ont besoin de relève et de forces vives. Ce n’est pas une faveur que nous faisons aux nouveaux arrivants de partager le territoire avec eux. Malheureusement, bien des sensibilités face à l’immigration viennent de l’ignorance et de la peur. Peur des pratiques religieuses différentes, réactions très émotives à des problèmes souvent gonflés et entretenus pas les médias. L’immigration n’est pas un problème, elle est une réalité. Je ne partage pas la paranoïa de ceux qui pensent que les immigrants sont un problème. Je trouve que la peur de l’autre est un problème bien plus grand.
D’ailleurs, la nature ne veut pas que les êtres vivants restent dans leur coin et se reproduisent à l’infini par eux-mêmes. Elle a donné le pouvoir aux insectes de transporter le pollen, aux oiseaux, les graines des arbres et des fleurs. Les mélanges génétiques sont la clé de l’adaptation aux changements perpétuels de la planète et les humains n’y font pas exception.