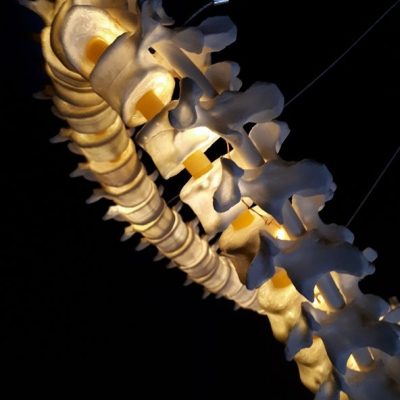L’affaire de la harde de caribous de Val-d’Or fait les manchettes au Québec, y compris dans les pages de ce journal. La harde fragile ne compte plus aux yeux du gouvernement, qui cherche activement à la supprimer. Avec une simplicité désarmante, le ministre Blanchette proposait de trainer les bêtes au zoo.
Le ministre semble avoir fait volteface dans ce dossier. Or, les caribous sont encore menacés. Le dernier scénario en date consiste simplement à attendre la mort de la harde : on passe de l’apparence de conservation à l’indifférence déclarée. De toute manière, les bêtes sont une entrave au bien commun — formule au référent ambigu. Le premier ministre Couillard a clairement dit, avec raffinement et sagesse, qu’il n’allait pas sacrifier « une seule job dans la forêt pour les caribous ». Le gouvernement veut se décharger de ses responsabilités en matière de protection écologique afin d’intensifier, encore et toujours plus, l’exploitation de la nature. Tant pis pour les espèces en péril, le bulldozer du progrès et de la dévastation écologique a le droit de passage.
L’histoire m’a frappé parce qu’elle montre le peu d’empathie que nous avons pour le plus-qu’humain, la myriade de créatures et de communautés, de phénomènes et d’éléments avec lesquels nous collaborons pour faire et habiter la Terre : animaux, fongus, lichens, plantes et protistes; écosystèmes et relations symbiotiques; aurores boréales, eaux, nuages et pierres; collines vallonnées, marais herbacés, lacs gelés.
Ce manque d’empathie, si flagrant dans le plan de gestion du caribou des libéraux, s’explique sans doute par le fait que notre vie collective est encore trop souvent réglée sur un nationalisme racial. L’humain administrera tout dans son intérêt — ou dans l’intérêt de quelques privilégiés. Tout ce qui souffre et meurt comptera comme du dommage collatéral de l’inarrêtable grandeur technocapitaliste de l’Homme. Ne pas avoir d’empathie pour les autres tient de notre refus de coexister avec les autres, voire d’imaginer cette coexistence. C’est pourquoi tant de nos histoires portent sur les vicissitudes humaines, comme si le plus-qu’humain ne pouvait faire l’objet de récits. Mais que nous révèle la stratigraphie sédimentaire, sinon une longue saga géologique? Que nous enseigne la biologie évolutive, sinon le dialogue entre des formes organiques, un dialogue construit sur le flot continu de générations d’espèces? Les humains ont des récits aujourd’hui parce que le monde vivant s’écrit et se lit des récits depuis une éternité.
L’histoire du caribou des bois s’écrit et se lit depuis des milliers d’années, au travers d’innombrables opérations d’épissage génétique. Elle s’est inscrite dans et avec la forêt boréale, les pistes, les points d’eau, les aires de repos. Elle s’est écrite dans et avec les lacs, les vents, les autres espèces que confrontent et que côtoient ces cervidés. Les responsables gouvernementaux, armés de toutes leurs lumières, ont-ils même considéré l’histoire de la harde avant de la biffer, condamnant d’un trait ses membres à croupir dans un zoo? Pourquoi ne pas vivre auprès de cette entité fragilisée, revenir et raconter son histoire dans le but de nous rapprocher, de nous ressentir et de nous comprendre? Le gouvernement a-t-il envisagé une situation réellement accueillante à l’égard des caribous? Permettez-moi d’en douter.
Comme une personne sur son lit de mort sait et sent que sa vie se dissipe, cette harde doit bien se savoir en détresse. Elle doit bien se rendre compte que sa vie, autotélique et symbiotique, implose. Lesdites solutions du ministre — enfermer les survivants et survivantes comme pour les punir d’être toujours en vie, les laisser crever — sont aussi niaiseuses que cruelles. Accepterons-nous de reconnaitre la peine et la souffrance de ces bêtes sur le seuil de la mort? D’en faire le deuil? De faire une introspection collective sur le rôle de quelques humains arrogants, avares et orgueilleux?
Dans Un thé dans la toundra/Nipishapui nete mushuat, Joséphine Bacon réagit à la dévastation écologique et, par extension, à son impact sur le caribou de la Côte-Nord :
Je demande pardon aux Maîtres des animaux
J’ai omis de me lever
Quand on saccageait
Ton corps
On salissait tes veines
Bacon crée et exprime sa relation avec le monde vivant. Ce travail de la langue transforme les gens qui s’en servent. Ce qui est exigé ici, c’est de reconnaitre la versatilité de la signification, au-delà des œillères étroites de la rationalité. Dans le risque linguistique qui est pris, il y a une autre manière de vivre le monde et de vivre notre engagement auprès de nos semblables. Accepterons-nous d’accueillir ces histoires? De forcer le langage sur des sentiers inhabituels et de se laisser surprendre par ce que cela occasionnera en nous, l’hospitalité à l’égard du plus-qu’humain?
Cet article est adapté d’un texte à paraitre dans The Goose. A Journal of Arts, Environment and Culture in Canada. Ce texte est également une suite à l’article signé par Henri Jacob et Richard Desjardins dans le numéro de JUIN 2017.