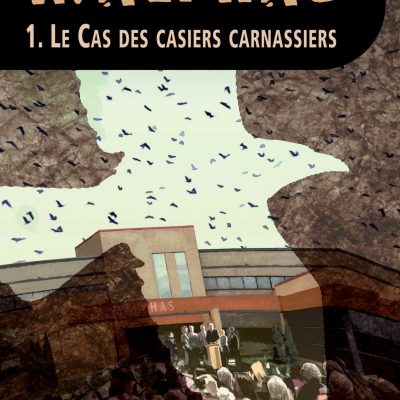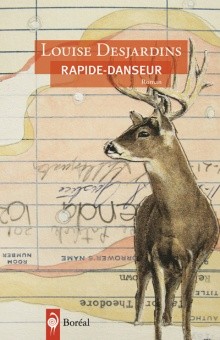Par sa transcendance du pathos, L’enfant hiver, le dernier roman de Virginia Pésémapéo Bordeleau, se signale comme un livre de célébration. Pourtant, son thème est douloureux, déchirant. Il s’agit d’une mère qui raconte la maladie, l’agonie, bref, la fin de son fils, sur la trame de quelques souvenirs de sa propre enfance avec un père silencieux, impénétrable et énigmatique. La romancière propose en effet un voyage paradoxal initié dès le début du roman avec cet enfant qui refuse de naître, en s’accrochant inexorablement à son cordon ombilical, forçant l’accoucheur à recourir aux grands moyens pour le déloger tel un squatter indésirable. Ce refus de naître est tout simplement un refus de mourir, et la naissance, un subterfuge adroit pour nous bousculer vers la mort. Quel est le destin du nouveau-né si ce n’est la mort ? Telle est la désespérante question qu’on peut se poser en lisant le livre.
Heureusement, Virginia Bordeleau ne se complait pas à n’exprimer que la douleur de la perte, le poids de l’absence ou les déchirements d’un cœur de mère meurtrie; elle célèbre surtout la délicatesse des sentiments, l’érotisme subtil qu’on lui a découvert dans L’Amant du lac et le triomphe de la vie sur la mort. Ne refuse-t-elle pas le suicide comme solution ? N’écrit-elle pas en exergue : « Y a-t-il une vie avant la mort? » L’écriture de ce roman porte tous les signes d’un processus de deuil. Ce dernier est pénible. Les souvenirs de l’enfant qui s’en est allé décuplent la pénibilité du deuil. La narratrice éplorée livre un flash-back sur la vie du disparu pour en relater chaque étape importante : sa naissance, sa maladie, sa dépression, son déménagement, sa peine d’amour, etc.
En remontant le temps, elle parvient à prendre un recul significatif par rapport à son deuil et à aller de l’avant. Mais on voit ses inquiétudes, sa solitude, sa désespérance, ses frayeurs, sa résilience. On découvre vite que cet enfant disparu portait la vie en lui comme une culpabilité honteuse : « Maman, s’il avait vécu, ton bébé, je ne serais pas là? J’ai pris sa place, maman? » Dérangeante question pour une mère qui ne saurait admettre la véracité de la réponse. Mais elle réalisera que le départ définitif de cet enfant écorché qui refusait de naître apporte une certaine sérénité à sa vie. Elle écrit avoir dormi « calmement la première fois depuis la veille de sa naissance ». Cette révélation représente en quelque sorte la clef de la réussite du processus de deuil de Virginia Bordeleau.
La deuxième partie du roman, très sobrement intitulée « La vie », s’ouvre sur la perspective d’un échange entre la mère et le fils disparu. En donnant la parole à l’enfant parti, Virginia Bordeleau le réhabilite dans le monde des vivants et sollicite son approbation pour continuer son cheminement : « Dis-moi que je me dois de vivre et que la musique n’est pas morte avec toi. » La voix du fils retentit, injonctive, pour demander à la mère de vivre. Cette réponse est un message d’espoir, un message positif pour le lecteur confronté au deuil d’un être cher.