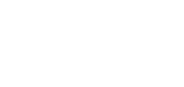MYRIAM BENOÎT, CHARGÉE DE PROJETS, CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (CREAT)
Et si la mort était une des plus grandes alliées de la vie? Souvent perçue comme une fin ou un désagrément, elle joue pourtant un rôle fondamental dans le maintien des équilibres écologiques. Loin d’être une simple finalité, elle est un moteur de régénération, de transformation et de continuité.
FEUILLES ET ARBRES MORTS : DES REFUGES POUR LA BIODIVERSITÉ
Chaque automne, les feuilles tombent et recouvrent le sol, constituant encore une ressource précieuse. En hiver, elles forment une couche isolante qui protège les jeunes pousses du froid et offrent un abri à de nombreux petits animaux en hibernation. Leur retrait systématique peut perturber ces microhabitats essentiels. Déchiquetez-les directement au sol ou regroupez-les au pied des plantes et arbustes pour former un paillis écologique qui protège du froid, limite les mauvaises herbes et réduit les besoins en engrais et en déchets verts.
Les arbres morts, appelés chicots, jouent eux aussi un rôle crucial. Leurs cavités, crevasses et structures complexes abritent un grand nombre d’espèces. Certains animaux y élèvent leurs petits et d’autres s’y réfugient pour se protéger des intempéries et/ou des prédateurs. La disparition des vieilles forêts, riches en chicots, menace directement les espèces dépendant de ces refuges naturels.

DÉCOMPOSEURS ET CHAROGNARDS : DES RECYCLEURS EFFICIENTS
Les décomposeurs et les charognards sont également essentiels au cycle de la vie. Vers, champignons et insectes transforment la matière organique en nutriments utiles au sol. Les charognards, eux, éliminent rapidement les carcasses, prévenant la propagation de maladies, assumant ainsi un rôle sanitaire primordial en limitant la propagation de pathogènes.
CASCADES TROPHIQUES : QUAND LA MORT CHANGE TOUT
La disparition d’un prédateur peut déclencher une réaction en chaîne aux conséquences insoupçonnées. Ce phénomène, appelé « cascade trophique », illustre parfaitement comment la mort s’inscrit dans le grand cycle de la vie. L’exemple le plus célèbre est celui des loups du parc de Yellowstone. Leur disparition au début du vingtième siècle a provoqué une explosion des populations de cerfs, qui ont alors surpâturé la végétation riveraine. Les berges se sont érodées, les castors ont disparu, faute de saules pour construire leurs barrages, et même le cours des rivières s’est modifié. Lorsque les loups ont été réintroduits en 1995, leur présence, et surtout leur rôle de prédateurs, a permis de restaurer le cycle naturel : les cerfs, désormais plus prudents, ont modifié leurs comportements de broutage; la végétation s’est régénérée; les oiseaux sont revenus nicher et les castors ont reconstruit leurs barrages, stabilisant ainsi les cours d’eau. Paradoxalement, c’est la mort provoquée par les loups qui a permis à la vie de reprendre son cours. La prédation n’est pas une violence gratuite : elle est un maillon essentiel du cycle perpétuel qui régénère et équilibre les écosystèmes.

LA MORT AU SERVICE DE LA VIE
L’humain perturbe l’équilibre naturel entre la vie et la mort en voulant nettoyer et retirer toute trace de mort de son environnement. En reconnaissant la valeur écologique de la mort, nous pouvons mieux comprendre les dynamiques naturelles qui nous entourent et peut-être réapprendre à vivre en harmonie avec elles. Chaque mort nourrit la vie suivante, bouclant ainsi la boucle infinie qui soutient la biodiversité.