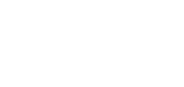MAJED BEN HARIZ
L’histoire du cinéma au Témiscamingue a été marquée par le tournage de plusieurs films et documentaires faisant la promotion de l’installation des colons et de l’industrie minière.
À partir des années 1970, avec l’essor du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (FCIAT), un moteur culturel important pour la région, le Témiscamingue devient une destination prisée pour les tournages, comme en témoignent des films de Sophie Dupuis et Philippe Falardeau tournés dans la région.

Le cinéma a joué un rôle important dans la vie culturelle du Témiscamingue. Plusieurs centres communautaires ainsi que des paroisses ont contribué au développement de ce secteur d’activité. Avec la fermeture graduelle de plusieurs salles de cinéma traditionnelles, le cinéma itinérant et les festivals de films régionaux ont pris le relais pour maintenir l’accès à cette forme d’art.
Dès la fin du 19e siècle, le territoire témiscamien est un lieu de tournage de plusieurs films qui marquent le début du cinéma canadien. Par exemple, le camp des Topping, « lieu mythique situé à l’embouchure de la rivière Kipawa et du lac Témiscamingue, a été le décor de cinq films alors que le septième art en était à ses balbutiements » (Radio-Canada, 2017). Au début des années 1920, Fred Arnott met la main sur le camp, qu’il baptise le pavillon Tim-Kip. Il déclare alors que c’est « un endroit idéal à utiliser comme plateau de tournage ». Le film le plus célèbre tourné au Témiscamingue est The Snow Bride, un drame muet réalisé par Henry Kolker et produit par Paramount Pictures en 1923, rapporte Scott Sorensen dans ses Chroniques de la rivière Kipawa. Par la suite, d’autres films ont été tournés en ces lieux, comme Indians Before Civilisation, Capitaine, American Medium ainsi que The Silent Enemy, de Douglas Burden, un documentaire de 1930 qui traite de la fierté et de la puissance des Ojibwés avant l’arrivée des colons.
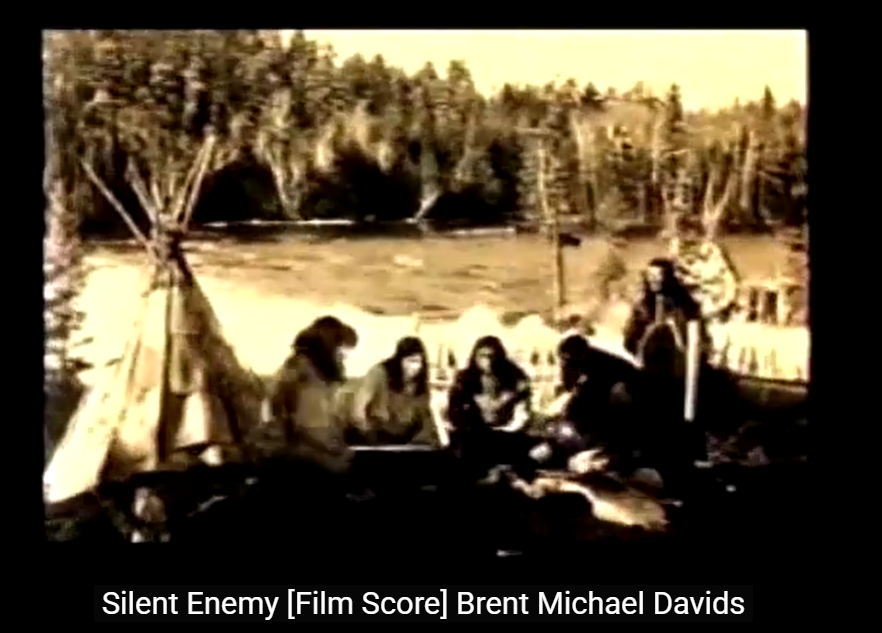
Réal Couture, une référence en culture et témoin des grands évènements culturels des cinquante dernières années, précise que « plusieurs réalisateurs sont originaires du Témiscamingue et ont participé, à travers leurs travaux, au développement de la filière », citant ici Sylvain Marcotte, qui a réalisé le film La messe du chasseur (2004) et La terre se lève (2005). Émilie Lessard-Therrien a également réalisé un long métrage documentaire portant sur l’agriculture locale (2016). Des Témiscamiens ont aussi brillé dans la catégorie des courts métrages, comme Sarah Baril-Gaudet qui a réalisé Là où je vis (2018) qui a remporté plusieurs prix. En 1984, Claude Gagnon a tourné des scènes de son film Visages à Belleterre. En 1987, dans le cadre du FCIAT, le Témiscamingue a accueilli le grand cinéaste Claude Lelouch accompagné de Jean-Claude Lauzon et de Jean Claude Labrecque. Pour la petite histoire, on aurait convaincu M. Lefort, propriétaire du cinéma, que sa salle était essentielle à la vie culturelle de la région.
Au Témiscamingue, le cinéma gravite aujourd’hui autour du Rift qui joue un rôle central dans la diffusion et la projection de films. Durant les années 2000, des discussions concernant une salle pour développer le cinéma par un partenariat public-privé avec le cinéma de Ville-Marie, propriété des productions de la Rive, ont mené à l’ouverture du Théâtre du Rift, une salle multifonctionnelle qui accueille la majorité des activités culturelles de la région, dont la projection des films.